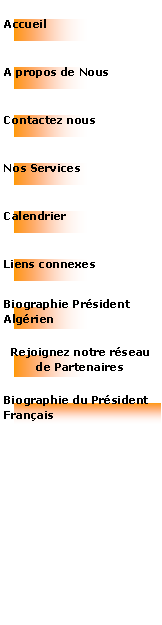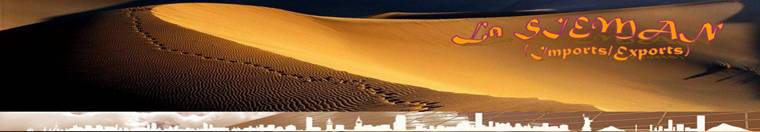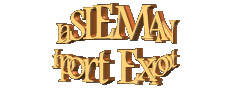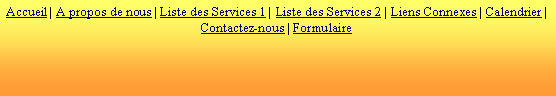Nicolas Sarkozy (nom usuel de Nicolas, Paul, Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa), né le 28 janvier 1955 dans le XVIIe arrondissement de Paris, est un homme politique français candidat à la présidence de la République. Le 6 mai 2007 le ministère de l'intérieur a annoncé qu'il a obtenu une majorité des suffrages lors du second tour de l'élection. , il devient ainsi à 52 ans le 6e président de la Ve République et le 23e président de la République. Il prend normalement ses fonctions le 16 mai 2007, succédant à Jacques Chirac.
Ancien ministre, il est président du conseil général des Hauts-de-Seine. Il est également président de l'Union pour un mouvement populaire (UMP).
Il est le fils d'un immigré hongrois, Pál Sárközy de Nagybocsa (en hongrois nagybócsai Sárközy Pál[2]) né à Budapest, en 1928, dans une famille de la petite noblesse hongroise (anoblie le 10 septembre 1628 par l'Empereur Ferdinand II, roi de Bohême et de Hongrie)[3]. Son ancêtre, un paysan qui s'est battu vaillamment contre les Turcs, n'a pas reçu de réel titre de noblesse mais seulement le droit de faire suivre son nom (« Sárközy », qui veut dire « petit lieu marécageux » en magyar) par celui de son village d'origine et l'usage d'un blason[4]. Les armoiries de famille sont « de gueules à un loup d'or tenant en sa dextre un sabre dressé d'argent, soutenu d'une terrasse de sinople ». À l'arrivée de l'Armée rouge en 1944, la famille est expropriée et contrainte à l'exil. Après de nombreuses péripéties à travers l'Autriche et l'Allemagne, Pál Sárközy rencontre un recruteur de la Légion étrangère à Baden-Baden. Il s'engage pour cinq ans et fait ses classes en Algérie à Sidi-Bel-Abbès. Il est cependant déclaré inapte au départ pour l'Indochine, puis démobilisé à Marseille en 1948. Il francise alors son nom en Paul Sarközy de Nagy-Bocsa. Devenu publicitaire, il rencontre en 1949 Andrée Mallah, qu'il épouse. Cette dernière, fille d'un chirurgien du XVIIe arrondissement de Paris, juif séfarade de Salonique converti au catholicisme, est alors étudiante en droit.
Nicolas Sarkozy naît en 1955 dans le XVIIe arrondissement de Paris. Il a deux frères : Guillaume, né en 1952, futur chef d'entreprise dans le textile (vice-président du MEDEF entre 2000 et 2005) et François, né en 1957, qui devient pédiatre puis chercheur en biologie. Lorsque Paul Sarkozy quitte le domicile conjugal en 1959 et divorce, sa femme reprend ses études pour élever ses enfants. Elle devient avocate au barreau de Nanterre ; elle plaide dans l'affaire Villarceaux. Paul Sarkozy se remariera trois fois. De son deuxième mariage, il aura deux autres enfants : Caroline et Pierre-Olivier, banquier à New York.
Nicolas Sarkozy commence ses années de collège au lycée public Chaptal, il y redouble sa sixième, puis entre au lycée privé Saint-Louis de Monceau. Il obtient le baccalauréat B en 1973 et sa famille s’installe à Neuilly. Après des études à l’université Paris X, il sort diplômé en droit public et en sciences politiques : il obtient une maîtrise de droit privé en 1978. Il finance ses études en étant, entre autres, livreur pour un fleuriste de la ville[5]. Toujours en 1978, il est appelé sous les drapeaux, avant d’entrer à l’Institut d'études politiques de Paris. Il n'obtiendra pas le diplôme de fin d’études à cause de notes éliminatoires en anglais[5]. Il soutient en 1981 un mémoire de DEA sur le référendum du 27 avril 1969.
En 1981, après avoir longtemps hésité à devenir journaliste, il se résout au dernier moment à passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), suivant ainsi les traces de sa mère.
Il est embauché par l'avocat Guy Danet puis devient l'un des trois associés du cabinet d'avocats parisien « Leibovici - Claude - Sarkozy », un cabinet comprenant onze avocats et spécialisé dans le droit immobilier. Cependant, l'exercice de l'activité d'avocat étant incompatible avec toute autre activité, il n'exerce pas cette profession pendant ses périodes d'activité gouvernementale mais, détenant un tiers des parts du cabinet, il reçoit un dividende des profits du cabinet (241 000 euros en 2002).
Le 23 septembre 1982, Nicolas Sarkozy épouse Marie-Dominique Culioli, fille d’un pharmacien corse de Vico dont il a deux fils, Pierre (né en 1985) et Jean (né en 1987). Son témoin de mariage est Charles Pasqua.
En 1984, il rencontre Cécilia Ciganer-Albeniz lorsqu’en qualité de maire de Neuilly, il la marie à l’animateur de télévision Jacques Martin, qu’elle quitte pour lui en 1989. Après un divorce en quatre mois, il l'épouse en octobre 1996. Il a pour témoins Martin Bouygues et Bernard Arnault. Un fils, Louis, naît en 1997.
Il adhère à l’Union des démocrates pour la République (UDR) en 1974 où il rencontre Charles Pasqua et Joseph Jeffredo et milite pour l’élection de Jacques Chaban-Delmas. En 1975 il devient le délégué départemental des jeunes des Hauts-de-Seine. En 1976, il adhère au Rassemblement pour la République (RPR) nouvellement créé, sous le parrainage de Charles Pasqua à propos duquel il déclare en 1983 « tout le monde sait que je suis son double ». Il devient responsable de la section de Neuilly en 1976, secrétaire de la circonscription Neuilly-Puteaux en 1977, et est élu conseiller municipal de Neuilly en 1977.
Il est président du comité de soutien des jeunes à la candidature de Jacques Chirac en 1980[6].
En 1983, il devient maire de Neuilly-sur-Seine à 28 ans, succédant à Achille Peretti, décédé, mais aussi en prenant de court le prétendant en titre, Charles Pasqua, alors hospitalisé pour l’opération d’une hernie. Il est chargé de mission de mars 1987 à mai 1988 pour la lutte contre les risques chimiques et radiologiques au sein du ministère de l'Intérieur[7]. Il devient député à 34 ans et ministre du Budget à 38 ans.
Lors de la large victoire de la droite aux élections législatives de 1993, il est réélu député de Neuilly au premier tour avec 64,90% des voix puis nommé ministre du Budget dans le gouvernement Édouard Balladur. Il y fait son apprentissage des rouages gouvernementaux. Il est le porte parole du gouvernement[8] et il commence alors à se faire connaître du grand public.
En 1993, lors de l’affaire de la maternelle de Neuilly, ville dont il était maire, Nicolas Sarkozy participe aux négociations avec un homme cagoulé armé d'un pistolet et d'une charge d'explosifs, « Human Bomb », qui tenait en otage 21 enfants dans une classe, et fut finalement abattu par le RAID.
En 1995, il soutient Édouard Balladur contre Jacques Chirac pour la campagne présidentielle. À la suite de la victoire de Jacques Chirac, il n'obtient aucun poste ministériel dans le nouveau gouvernement d'Alain Juppé. Au cours d'un bref passage à une réunion nationale du RPR, le 15 octobre 1995, il est sifflé.
D'avril à octobre 1999, il devient président par intérim du RPR, succédant à Philippe Seguin qui en avait démissionné brutalement. Il conduit conjointement avec Alain Madelin la liste RPR-Démocratie Libérale aux élections européennes de 1999, et devient tête de liste conséquemment au départ de Philippe Seguin. Ces élections sont marquées par une sévère défaite : la liste arrive en troisième position avec seulement 12,8 % des suffrages (contre 25,58 % pour l'union RPR-UDF, arrivée en première place, conduite par Dominique Baudis en 1994 et 16,4 % pour l'UMP en 2004), derrière celle de Charles Pasqua (13,1%). Il abandonne alors toute responsabilité au sein du parti et se retire de la politique nationale. Pendant cette période, il rejoint à nouveau le cabinet d'avocat dont il s'était mis en suspension et publie en 2001 un livre, Libre.
La XIIe législature est une ascension pour Nicolas Sarkozy, tant politique (gouvernementale et de parti) que médiatique et populaire. Il est réélu député de Puteaux et Neuilly sur Seine à l'occasion des élections législatives de 2002. Il est le député de droite le mieux élu, avec 68,78 % des voix. Après le 21 avril 2002, il devient la cible privilégiée des critiques de l'opposition.
En 2002, il soutient la réélection de Jacques Chirac. Celui-ci lui préfère Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre mais le nomme ministre de l'Intérieur. Il impose un style « musclé » et fait de la sécurité sa priorité, déclarant vouloir s'affirmer par l'action.
Il organise avec Gilles de Robien, ministre des transports, une politique plus répressive sur les excès de vitesse destinée à renforcer la sécurité routière. Cette politique dont l'aspect le plus emblématique sera la multiplication des radars automatiques sur les routes contribue à une baisse du nombre de morts de 7272 à 4703 entre 2002 et 2006 (-34%). On observe cependant en 2007 une remontée des chiffres (+6% de tués, +10% de blessés entre 2006 et 2007, sur les trois premiers mois).
Il soutient la mise en place du Conseil français du culte musulman (CFCM) initiée en 1999 par Jean-Pierre Chevènement et intervient sur les dossiers de l'éducation et des retraites.
Par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003[9], complétée par la Loi Perben[10], le fichage ADN, instauré en 1998 et limité à l'origine aux délinquants sexuels, a été étendu à toute personne soupçonnée d'un quelconque délit (sauf délit d'initié ou financier), et laissées au libre choix des policiers et des gendarmes, sans que les preuves de culpabilité ne soient obligatoirement établies[11]. Cette loi a permis le fichage génétique de faucheurs d'OGM, d'étudiants anti-CPE[12] et deux frère de 8 et 11 ans pour avoir volé 2 tamagotchi et 2 balles magiques [13]. Les personnes refusant de se laisser ficher risquent jusqu'à 15 000 euros d'amende et 1 an de prison.
Quelques semaines après son élection, Nicolas Sarkozy a effectué deux voyages en Afrique, l'un en Libye, l'autre en Afique de l'Ouest. Il a notamment prononcé un long discours[93] à l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Dans ce discours, rédigé par Henri Guaino, le Président français déclare notamment que la colonisation fut une faute tout en estimant que le problème principal de l'Afrique venait de ce que « l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. (...) Le problème de l’Afrique, c’est qu’elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance. (...) Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès »[94]. Ce discours a suscité de nombreuses réactions en France[95] et dans le monde[96],[97],comme celle du professeur Achille Mbembe[98]. Doudou Diène, rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, a déclaré à la tribune de l'ONU que « dire que les Africains ne sont pas entrés dans l’histoire est un stéréotype fondateur des discours racistes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle »[99].
Le Président français s'est également rendu au Gabon, dont il avait reçu le Président quelques semaines plus tôt.
Nicolas Sarkozy et le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner organisent la conférence de Paris, réunissant une vingtaine de pays[100], afin de relancer le processus sur le Darfour le 25 juin 2007. Bernard Kouchner lance l’idée d’un corridor humanitaire. Suite à la réunion, la création d'une force hybride de 20 000 hommes devant être déployée au Darfour, force comportant des membres de l’Union africaine et de l’ONU, est annoncée[101]. Le 31 juillet 2007, l'ONU approuve à l'unanimité l'envoi de troupes au darfour[102].
Lors du sommet européen du 8 au 10 juin 2007 présidé par l’Allemagne, Nicolas Sarkozy défend l’idée d’un « traité simplifié » entre les partenaires européens, reprenant en grande partie les articles du projet de constitution européenne, notamment la partie institutionnelle. Après de longues négociations avec en particulier le président polonais Lech Kaczynski, ce projet est adopté le 23 juin 2007[103].
Le président prévoit de ne pas avoir un équilibre budgétaire avant 2012, cependant le gouvernement précédent avait promis à l’Eurogroupe de rétablir cet équilibre en 2010. Face au mécontentement des ministres des Économies des pays de l’Union européenne, Nicolas Sarkozy décide de défendre lui-même sa politique budgétaire en se rendant à la réunion des ministres de l’Eurogroupe[104]. Le résultat de cette réunion a été considéré par une partie de la presse française comme une victoire de Nicolas Sarkozy qui aurait convaincu ses partenaires en affirmant que son « choc fiscal » permettrait de relancer la croissance et de revenir dans les critères de Maastricht à l’horizon 2012, tandis que la presse étrangère se montre généralement plus sceptique.
L’Union méditerranéenne est un projet d'union supranational, proposé aux pays bordant la mer Méditerranée. Il a été suggéré par le président français Nicolas Sarkozy comme une alternative à l’adhésion turque à l’Union européenne, qui formerait au lieu de cela le point d’appui de la nouvelle union. Le président prévoit une première réunion à l'horizon de juin 2008[105].
Haut de page